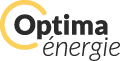Le marché du pétrole a connu d’importantes fluctuations depuis le début de l’année 2025. Après une hausse significative en janvier portée par des tensions géopolitiques, alimentant la volatilité du marché de l’énergie, les prix sont repartis à la baisse sur le reste du premier semestre. Pour autant, la deuxième quinzaine de juin est reparti avec de forte hausse du fait du conflit entre l’Iran et Israël. Depuis l’automne 2025, les cours évoluent dans un couloir relativement étroit, reflétant un marché partagé entre excédent d’offre, ralentissement de la demande et primes de risque géopolitique.

Le pétrole dans une phase de range fin 2026
Un marché tiraillé entre géopolitique et fondamentaux
Le marché pétrolier reste soumis à des forces contradictoires. Depuis la mi-septembre, les cours évoluent dans un environnement instable, marqué par la surabondance d’offre et les décisions contrastées de l’OPEP+, sur fond de durcissement des sanctions américaines contre la Russie. La croissance mondiale plus faible qu’anticipé en 2025 et les signaux de ralentissement industriel en Europe et en Chine limitent également le potentiel haussier de la demande de brut.
Rebond temporaire début novembre
Le 3 novembre, le Brent a rebondi à 65,07 $/baril, effaçant en deux jours les pertes accumulées depuis trois semaines. Ce revirement s’explique principalement par les sanctions ciblant Rosneft et Lukoil, qui incitent l’Inde et la Chine à revoir leurs stratégies d’achat.
Malgré ce sursaut, les fondamentaux restent orientés à la baisse : volumes record transportés par voie maritime, stocks élevés et OPEP+ envisageant encore une légère augmentation de production en décembre. Ce rebond apparaît donc davantage lié à des facteurs géopolitiques ponctuels qu’à un changement structurel de l’équilibre offre/demande. La faiblesse persistante des marges de raffinage en Europe confirme ce diagnostic d’un marché bien approvisionné.
Pression baissière depuis mi-octobre
Le 20 octobre, le Brent avait chuté à 61,91 $/baril, sous la pression des prévisions de l’AIE : excédent mondial de près de 4 millions de barils/jour en 2026, production en hausse (+3 Mb/j en 2025) et demande en ralentissement. L’OPEP maintient ses prévisions de demande inchangées, créant une divergence d’analyse.
Les tensions commerciales États-Unis/Chine et la hausse des exportations russes malgré les sanctions accentuent l’incertitude. Les analystes, dont Goldman Sachs, anticipent un surplus prolongé avec un prix moyen potentiel autour de 56 $/baril à moyen terme. Les dernières projections de l’AIE et de l’EIA confirment un scénario de marché « bien approvisionné » jusqu’en 2026, sauf choc géopolitique majeur.
Légère stabilisation mi-octobre
Le 13 octobre, le Brent se stabilisait à 63,68 $/baril, bénéficiant d’un rebond temporaire après les lourdes pertes précédentes. La décision de l’OPEP+ de limiter sa hausse de production à 137 000 barils/jour pour novembre, au lieu de 500 000 barils, a apaisé les craintes d’un excédent massif.
Cependant, les signaux baissiers persistent : stocks élevés, saturation du transport maritime et excédent attendu jusqu’en 2026 selon l’EIA et Goldman Sachs. Les attaques de drones ukrainiens sur les infrastructures russes continuent d’alimenter une prime de risque géopolitique. Cette prime reste toutefois contenue, ce qui explique que les cours ne parviennent pas à s’installer durablement au-dessus de 70–75 $/baril.
Perspectives et volatilité du marché du pétrole en 2026
En ce début novembre 2025, le prix du pétrole demeure volatil, dépendant des événements politiques internationaux et des décisions ponctuelles de l’OPEP+. La surproduction mondiale reste un frein à toute remontée durable des cours, maintenant le marché dans un équilibre instable entre tensions géopolitiques et fondamentaux fragiles. À la fin de l’année 2025 et au début de 2026, le Brent évolue globalement dans une fourchette ~60–70 $/baril, avec un WTI quelques dollars en dessous, illustrant un marché plus « mou » que réellement haussier.
Facteurs influençant le marché du pétrole en 2025
Offre accrue et demande modérée :
Offre accrue et demande modérée : L’OPEP+ a surpris en relevant ses quotas, argumentant de la « faiblesse des stocks ». Cette hausse d’offre prévue pèse sur les prix. Par ailleurs, l’AIE anticipe un large excédent d’offre plus tard dans l’année. Simultanément, les tensions commerciales et les indicateurs économiques amoindrissent les perspectives de demande mondiale.
Toutefois, la Chine reste une exception notable : la demande pétrolière chinoise a été meilleure que prévu en 2025. L’Inde confirme également son rôle de moteur de la demande, avec une croissance soutenue de la consommation de carburants en 2025, venant partiellement compenser le ralentissement européen.
Des prévisions du marché du pétrole hésitantes
Les incertitudes liées aux sanctions – aux nouvelles mesures européennes contre la Russie et aux tensions au Moyen-Orient restent un « premium » potentiel sur les cours.
À court terme, les cours du pétrole (Brent souvent compris entre 60 et 70 $/baril, WTI quelques dollars en dessous) restent confinés dans une fourchette étroite, reflétant un marché tiraillé entre signaux géopolitiques ponctuels et fondamentaux baissiers.
États-Unis : évolution des stocks de pétrole brut
La situation des réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis continue d’influencer le marché du pétrole. Les dernières données de l’EIA montrent une chute brutale des stocks américains de pétrole brut mi-septembre, ce qui devrait théoriquement soutenir les cours. Cependant, ce déclin s’explique principalement par un doublement des exportations d’une semaine à l’autre, et s’accompagne d’une accumulation importante de produits pétroliers distillés. Les fluctuations de ces stocks constituent un indicateur important pour les investisseurs et contribuent à la volatilité actuelle des prix. La reconstitution progressive des réserves stratégiques américaines depuis 2024 ajoute un paramètre supplémentaire à suivre pour les marchés.
Impact des sanctions américaines
De nouvelles mesures de rétorsion sont envisagées avec l’intensification coordonnée des sanctions contre le pétrole russe entre l’UE et les États-Unis, ce qui pourrait raviver les tensions sur les marchés. Malgré ces sanctions, les flux de brut russe détournés vers l’Asie continuent de peser indirectement sur l’équilibre global offre/demande, maintenant un « plafond » sur les prix.
Historique du cours du pétrole en 2025
Résumé du cours du Brent sur le troisième trimestre 2025
Évolution de juillet à septembre 2025 : Après des prix relativement stabilisés en juillet autour de 68-69$ pour le Brent, le marché pétrolier a entamé une phase de consolidation à la baisse depuis août. La forte augmentation des quotas OPEP+ et l’anticipation d’un excédent d’offre ont pesé sur les cours. Mi-septembre, le contexte se caractérise par une volatilité modérée autour de 67-68$ pour le Brent et 63-64$ pour le WTI, dans un équilibre précaire entre les tensions géopolitiques ponctuelles (attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes) et les fondamentaux baissiers (offre excédentaire, période d’entretien des raffineries réduisant la demande). L’escalade des sanctions UE-US contre la Russie et les incertitudes sur la demande mondiale dans un contexte de ralentissement économique maintiennent le marché dans l’expectative. Cette configuration de « range baissier » prépare le terrain à la phase de prix plus bas observée à l’automne.
Résumé du cours du Brent sur le deuxième trimestre 2025
Au premier trimestre 2025, les prix du pétrole ont connu une hausse marquée, portée par des tensions géopolitiques et une demande soutenue. En janvier, le Brent s’est établi en moyenne à 76,51 $/baril, tandis que le WTI atteignait 73,96 $/baril. Cette progression a été alimentée par la baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis (-3,6 % sur un an) et la forte demande en Asie et en Europe, notamment en Chine, où la reprise post-pandémie et les politiques de relance ont dynamisé la consommation énergétique. Les sanctions américaines contre la Russie ont exacerbé les inquiétudes, annonçant une possible réduction de l’offre de pétrole. Cependant, la Russie continue de contourner les sanctions, rendant leur impact incertain. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a ajusté ses prévisions de demande à la hausse, anticipant une augmentation de plus d’un million de barils par jour en 2025.
En mai 2025, le marché du pétrole a enregistré une baisse significative, avec le baril de Brent à 59,5 dollars, passant temporairement sous la barre symbolique des 60 dollars. Cette chute des prix sur le marché du pétrole fait suite à la décision de l’OPEP+ d’augmenter sa production. Cela refléte les préoccupations croissantes des investisseurs concernant l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché du pétrole mondial.
Cette tendance baissière contraste fortement avec le début de l’année, où les prix avaient connu une hausse portée par des tensions géopolitiques et une demande robuste. Les opérateurs se montrent désormais pessimistes face à la perspective d’une hausse de la production de l’OPEP+ pour le mois de juin, qui devrait être la troisième consécutive.
Perspectives du marché pétrolier en 2026
Les investisseurs s’accordent à penser que l’ensemble du marché pourrait connaître un excédent d’offre au second semestre 2025. Les analystes d’ING anticipent « un large excédent » plus tard dans l’année, malgré la forte demande saisonnière. L’AIE partage cette vision : après avoir souligné récemment des tensions d’approvisionnement, elle a revu à la baisse ses prévisions de demande mondiale tout en anticipant une hausse de l’offre. Ainsi, le scénario d’un pétrole bon marché est considéré comme plausible si la demande devait faiblir (par exemple en cas de recul de la croissance mondiale ou de nouveaux obstacles commerciaux). Pour 2026, plusieurs scénarios de prix se dessinent autour d’un Brent moyen compris entre 60 et 75 $/baril, avec un biais baissier en cas de ralentissement marqué de la demande.
Révisions des prévisions par les agences de l’énergie
Les perspectives pour 2025 sont incertaines. L’AIE prévoit une hausse de la demande de plus d’un million de barils par jour, mais la baisse de la production en Amérique du Nord et les sanctions contre la Russie pourraient resserrer l’offre et maintenir les prix sous pression. L’EIA anticipe un excédent d’offre, avec une augmentation de 1,8 million de barils par jour, ce qui pourrait faire baisser les prix à 74 dollars le baril. L’OPEP ajuste ses prévisions à la baisse, prévoyant une augmentation de la demande de 1,45 million de barils par jour.
Facteurs clés à suivre sur le marché du pétrole en 2025 :
- Sanctions contre la Russie : Leur impact global reste incertain, bien que le resserrement des approvisionnements semble probable.
- Demande en Asie, notamment en Inde et en Chine : L’augmentation continue de la demande, en particulier en Inde, pourrait soutenir les prix.
- Conditions climatiques et politiques : La production en Amérique du Nord pourrait être perturbée par des vagues de froid, et les décisions politiques aux États-Unis sous l’administration de Donald Trump influenceront l’offre et la demande mondiales.
Impact des tensions géopolitiques et des fluctuations des stocks
Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, affectent le marché du pétrole, avec des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et la mer Rouge. Le cessez-le-feu à Gaza pourrait apaiser les menaces sur les routes maritimes. Aux États-Unis, les réserves de pétrole brut chutent à des niveaux historiquement bas, suggérant un resserrement de l’approvisionnement. En Europe, les stocks de produits pétroliers augmentent, mais les hausses de gasoil et d’essence ne suffisent pas à compenser la pression sur le marché.
Historique de l’évolution du prix du pétrole en 2024
L’année 2024 a été marquée par de fortes variations du prix du baril de Brent. Cette évolution s’explique par des facteurs économiques et monétaires. Revenons sur les grandes tendances trimestrielles.
Premier trimestre 2024 : une hausse progressive du prix du baril de pétrole
En janvier, le prix du baril de Brent augmente de 2,9 %, atteignant 80 dollars. En février, l’accélération se poursuit avec une hausse de 4,3 %, portant le prix moyen à 83,5 dollars. La dépréciation de l’euro amplifie cette hausse en euros, qui atteint +5,4 %.
En mars, le rythme ralentit avec une hausse de 2,3 %, portant le baril à 85,4 dollars. En euros, l’augmentation est encore plus modérée (+1,6 %). L’appréciation de l’euro sur cette période explique ce ralentissement.
Deuxième trimestre 2024 : un pic en avril suivi d’un repli
En avril, le prix du baril de Brent atteint un sommet. Il augmente de 5,2 %, atteignant 89,8 dollars. En euros, l’augmentation est encore plus marquée (+6,7 %), sous l’effet de la faiblesse de l’euro.
En mai, le marché s’inverse. Le prix recule de 8,9 %, chutant à 81,9 dollars. En euros, la baisse atteint 9,8 %. L’appréciation de l’euro contribue à cette correction. Ce repli marque la fin d’une dynamique haussière amorcée en janvier.
Troisième trimestre 2024 : des fluctuations marquées sur le marché pétrolier
Le mois de juillet voit une reprise. Le baril augmente de 3,5 %, s’établissant à 85,2 dollars. En euros, la hausse est plus modérée (+2,7 %) en raison d’une appréciation de l’euro.
En août, le marché subit une nouvelle baisse. Le prix chute de 5,6 %, atteignant 80,4 dollars. En euros, le recul est encore plus prononcé (-7,0 %). Cette tendance se poursuit en septembre avec une baisse de 7,9 %, portant le baril à 74 dollars. En euros, le repli atteint 8,7 %, un plus bas depuis 2022.
Quatrième trimestre 2024 : stabilisation et tensions
En novembre, le prix du baril baisse légèrement (-2,0 %) pour s’établir à 74,1 dollars. En euros, le prix augmente légèrement (+0,5 %) en raison de la dépréciation de l’euro. Malgré cette stabilisation apparente, le marché reste sous tension. Sur un an, le prix du baril diminue de 10,6 % en dollars et de 9,2 % en euros.
Évolution du prix du baril de pétrole en 2024 ($)
| 2024 | Valeur |
| Novembre | 74,1 |
| Octobre | 75,6 |
| Septembre | 74,0 |
| Août | 80,4 |
| Juillet | 85,2 |
| Juin | 82,2 |
| Mai | 81,9 |
| Avril | 89,8 |
| Mars | 85,4 |
| Février | 83,5 |
| Janvier | 80,0 |
Source INSEE
Comment fonctionne le marché du pétrole ?
Le fonctionnement du marché
Le marché du pétrole repose sur l’interaction entre offre et demande. L’offre provient des compagnies qui extraient le pétrole, telles qu’Aramco, ExxonMobil ou TotalEnergies. La demande émane principalement des raffineurs qui transforment le brut en produits finis comme les carburants.
Deux types de marchés structurent les transactions pétrolières. Le marché de gré à gré, appelé « spot », gère les échanges physiques de barils. Ces transactions impliquent souvent des traders, qui achètent et revendent les cargaisons pour répondre aux besoins des raffineries ou réaliser des gains à court terme. Une cargaison peut changer de propriétaire plusieurs fois avant livraison.
En parallèle, le marché à terme, ou « papier », permet de vendre ou d’acheter du pétrole sur la base d’une valeur future. Les opérations se déroulent sur des plateformes comme le NYMEX à New York ou l’ICE à Londres. Ce système limite les risques de fluctuation des prix pour les producteurs et raffineurs. Cependant, la spéculation sur ce marché augmente la volatilité des cours.
Les principaux acteurs
Le marché du pétrole réunit une diversité d’acteurs. Les compagnies pétrolières produisent le brut, tandis que les raffineurs le transforment. Les traders assurent la fluidité des échanges en achetant et vendant des cargaisons ou des contrats à terme. Ces acteurs se fient à des prix de référence comme le Brent (Mer du Nord) et le WTI (West Texas Intermediate).
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) joue un rôle clé. Elle fixe des quotas de production pour stabiliser les prix. Ses décisions influencent directement l’économie mondiale, compte tenu de l’importance stratégique du pétrole.
Le marché du pétrole ne se résume pas qu’à l’OPEP. Plusieurs familles d’acteurs structurent son fonctionnement :
- Les compagnies pétrolières intégrées (majors) : ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies ou encore Saudi Aramco dominent l’exploration, la production et le raffinage. Leur poids financier et technologique leur permet d’orienter les flux mondiaux, notamment via leurs investissements massifs dans de nouveaux gisements ou dans les énergies alternatives.
- Les pays producteurs hors OPEP : les États-Unis (premier producteur mondial grâce au pétrole de schiste), la Russie, le Canada, le Brésil ou encore la Norvège jouent un rôle majeur. Ils ne sont pas liés aux quotas de l’OPEP mais influencent l’équilibre offre/demande, souvent en contrepoint des décisions de l’organisation.
- Les négociants indépendants (traders) : Vitol, Glencore, Trafigura et Gunvor écoulent chaque jour des millions de barils. Souvent invisibles pour le grand public, ces sociétés de trading assurent la fluidité des échanges, en reliant producteurs, raffineurs et consommateurs finaux.
- Les acteurs financiers : banques d’investissement, fonds spéculatifs et hedge funds interviennent sur les marchés à terme (NYMEX, ICE). En spéculant ou en couvrant leurs risques, ils amplifient parfois la volatilité des prix, ce qui peut compliquer la lecture du marché pour les entreprises consommatrices.
Les principales qualités de pétrole brut sur les marchés mondiaux
Sur les marchés mondiaux, le pétrole brut se décline en de nombreuses qualités, mais seulement quatre d’entre elles servent véritablement de référence pour fixer les prix.
Le Brent, un pétrole léger extrait en mer du Nord entre les îles Shetland et la Norvège, constitue la référence européenne et est coté à Londres.
Le West Texas Intermediate (WTI), également un pétrole léger, est principalement coté sur le marché américain. Il se distingue par une teneur en soufre plus faible que le Brent et est parfois appelé Texas Light Sweet.
Dubaï Light, quant à lui, est un pétrole produit dans le golfe Persique et destiné au marché asiatique, tandis que l’Arabian Light est extrait en Arabie Saoudite.
Les principaux marchés de fixation des prix :
- Nymex (New York Mercantile Exchange) : Basé à New York, spécialisé dans les métaux précieux et l’énergie (pétrole, gaz, électricité), avec une combinaison de négociations électroniques et à la criée.
- ICE (IntercontinentalExchange) : Basé à Atlanta et principalement actif à Londres, plateforme entièrement électronique créée en 2000, spécialisée dans le pétrole et d’autres produits énergétiques.

Les réserves de pétrole dans le monde
Les réserves mondiales de pétrole ont connu une croissance spectaculaire au cours des trois dernières décennies. En 2020, elles atteignaient environ 1 732 milliards de barils, soit 236 milliards de tonnes. Cela représente 52 ans de production mondiale au rythme actuel, bien que cette durée soit purement théorique en raison du déclin progressif des gisements.
Évolution des réserves : des chiffres qui parlent
Entre 1980 et 2020, les réserves prouvées de pétrole ont été multipliées par 2,3. En 1980, elles étaient estimées à 93 milliards de barils. En 2018, elles atteignaient leur pic à 236,8 milliards de barils. Cette augmentation est liée à l’exploration de nouveaux gisements et à l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, tels que les sables bitumineux et les huiles extra-lourdes.
Tableau : Évolution des réserves mondiales de pétrole (1980-2020)
| Année | Réserves (en milliards de barils) |
|---|---|
| 1980 | 93 |
| 2000 | 177,4 |
| 2010 | 223,3 |
| 2020 | 236,3 |
Répartition géographique : un paysage inégal
Les réserves de pétrole sont concentrées dans quelques régions du globe. En 2015, le Moyen-Orient détenait 47,3 % des réserves mondiales. Les principaux pays contributeurs étaient :
- Le Venezuela, avec 300,9 milliards de barils (17,7 % des réserves mondiales).
- L’Arabie Saoudite, avec 266,6 milliards de barils (15,7 %).
- Le Canada, avec 172,2 milliards de barils (10,1 %).
Malgré ces réserves abondantes, le coût d’extraction varie fortement. Les hydrocarbures non conventionnels du Venezuela et du Canada sont plus coûteux à exploiter que le brut saoudien.
 Vous trouverez plus d’infographie sur Statista
Vous trouverez plus d’infographie sur StatistaProduction et consommation : des tendances contrastées
La production mondiale de pétrole a atteint 34 milliards de barils en 2022, équivalant à 51 255 TWh. En parallèle, la consommation s’élevait à 52 969 TWh, ce qui explique une légère baisse des stocks.
Les principaux producteurs de pétrole en 2021 étaient :
- Les États-Unis : 706 millions de tonnes (17 % de la production mondiale).
- La Russie : 512 millions de tonnes (12,4 %).
- L’Arabie Saoudite : 511 millions de tonnes (12,3 %).
Cependant, les plus grands exportateurs restent l’Arabie Saoudite (352 millions de tonnes) et la Russie (269 millions de tonnes).
Tableau : Production mondiale par pays en 2021
| Pays | Production (en millions de tonnes) |
|---|---|
| États-Unis | 706 |
| Russie | 512 |
| Arabie Saoudite | 511 |
| Canada | 255 |
| Irak | 201 |
Enjeux et perspectives
Malgré l’abondance des réserves, la production future reste incertaine. Les gisements conventionnels stagnent depuis 2018, marquant un possible pic. La pandémie de COVID-19 a également perturbé les équilibres de consommation et d’extraction.
Les pays producteurs devront s’adapter à des contraintes économiques et environnementales croissantes. L’équilibre entre l’extraction d’énergies fossiles et la transition énergétique mondiale demeure un défi majeur.
Comment se forme le prix du pétrole ?
Le prix du pétrole ne dépend pas uniquement de l’offre et de la demande. Plusieurs mécanismes s’entrecroisent :
- Les prix de référence : le Brent (mer du Nord) et le WTI (États-Unis) servent d’indicateurs mondiaux. Même des pays qui ne produisent ni Brent ni WTI indexent leurs exportations sur ces références.
- Les marchés spot et à terme : sur le marché spot, les cargaisons sont vendues immédiatement. Sur le marché à terme, producteurs et acheteurs se couvrent contre les variations en fixant aujourd’hui un prix pour une livraison future. Ce marché financier est un outil de gestion du risque, mais il alimente aussi la spéculation.
- Le coût de production : il varie fortement selon les régions. Produire un baril en Arabie saoudite coûte moins de 10 dollars, tandis que le pétrole de schiste américain ou les sables bitumineux canadiens peuvent dépasser 40 à 60 dollars. Ces différences créent un “plancher” implicite pour les prix mondiaux.
- La prime géopolitique : tensions au Moyen-Orient, sanctions contre la Russie, piraterie maritime… autant de facteurs qui s’intègrent directement dans le prix du baril sous forme de “prime de risque”.
La logistique, maillon essentiel du marché du pétrole
Le pétrole ne vaut rien s’il ne circule pas. La logistique mondiale repose sur des routes stratégiques : le détroit d’Ormuz (20 % du commerce mondial de pétrole), le canal de Suez ou encore le détroit de Malacca. Tout incident (blocus, attaque, naufrage) peut provoquer une flambée immédiate des prix.
À cela s’ajoutent les coûts liés au transport (affrètement des pétroliers, assurances maritimes, taxes portuaires), qui influencent directement la facture des importateurs. Les tensions maritimes dans la mer Rouge ou dans le golfe Persique sont scrutées en permanence par les investisseurs et les acheteurs industriels.
Quelles implications pour les entreprises ?
Pour les professionnels, comprendre ces mécanismes est essentiel :
- Une hausse du baril entraîne mécaniquement des coûts plus élevés dans le transport routier, aérien et maritime, mais aussi dans l’industrie (plastiques, engrais, chimie).
- La volatilité des prix complique la gestion budgétaire des entreprises fortement consommatrices. C’est pourquoi nombre d’entre elles passent par des courtiers en énergie pour sécuriser leurs approvisionnements et anticiper les variations.
- Enfin, les décisions stratégiques (investir dans l’électrification, diversifier ses fournisseurs, recourir aux contrats long terme) doivent se prendre à la lumière de ces tendances mondiales.
FAQ sur le marché du pétrole
Quel le prix du baril de pétrole actuellement ?
Au 5 mai 2025, le prix du baril de pétrole Brent s’établit à 59,5 dollars, en dessous du seuil psychologique des 60 dollars.
Pourquoi le prix du pétrole est-il en baisse actuellement ?
Le prix du pétrole est en baisse principalement en raison de l’augmentation de la production de l’OPEP+, des inquiétudes concernant la demande chinoise et des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui affectent les perspectives économiques mondiales.
Quels sont les principaux pays producteurs de pétrole ?
Les principaux producteurs de pétrole en 2021 étaient les États-Unis, la Russie et l’Arabie Saoudite. Les plus grands exportateurs restent l’Arabie Saoudite et la Russie.
Quels sont les principaux facteurs qui influencent le marché du pétrole en 2025 ?
Les principaux facteurs influençant le marché du pétrole en 2025 sont les décisions de production de l’OPEP+, les relations commerciales entre grandes puissances économiques, la demande des pays émergents et les sanctions internationales affectant certains producteurs.
Quelles sont les prévisions de l’OPEP pour la demande pétrolière ?
L’OPEP maintient ses prévisions de croissance de la demande pétrolière, anticipant 105,2 millions de barils par jour en 2025 et 106,6 millions de barils par jour en 2026, soit une croissance annuelle de 1,4 million de barils par jour.